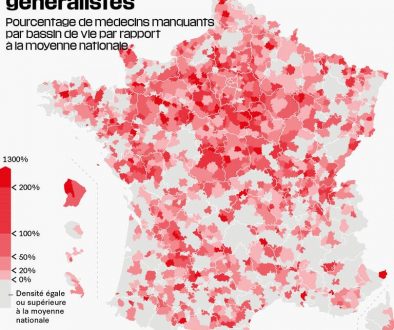La souveraineté alimentaire territoriale
C’est une question qui a mis du temps à prendre forme dans mon esprit, une question qui bouleverse nos habitudes, qui nous interroge sur la société dans laquelle nous vivons tout autant que notre place et le sens à donner à nos actions dans l’histoire de nos vies. Les terres qui nous entourent peuvent-elles nous nourrir, nous tous, habitantes et habitants du même bassin de vie ? Sommes-nous souverains pour nous alimenter, à quel point dépendons-nous d’autres territoires, d’autres pays ?
La question de l’origine des aliments que nous consommons est particulièrement troublante. Une assiette est un véritable tour du Monde, avocats du Mexique, tomates d’Espagne, viandes des Pays-Bas, d’Irlande ou de Roumanie, moutarde du Canada, ail de Chine ou d’Argentine, vin d’Afrique du Sud ou de Californie, kiwis de Nouvelle-Zélande… Tout ces fruits et légumes produits ici et là, sont chargés dans des camions, séjournent dans des chambres froides géantes, sont échangées dans des MIN – Marché d’Intérêt National (il en existe 17 en France), pour se retrouver sur les étals de la grande distribution, dans les assiettes des cantines, dans les plats préparés, mais aussi sur les marchés, dans les restaurants, dans la malbouffe, enfin partout.
Les importations représentent 70% des fruits et 30 % des légumes consommés en France. Sur ces produits importés, on estime qu’entre 30 et 40 % ne peuvent être produits sur le sol français car ce sont des produits exotiques. « Hormis des denrées telles que le café, le cacao, les bananes, qui seront toujours naturellement importées, a-t-on besoin de continuer à importer et pourquoi le faire ? », interrogeait Marion Guillou, membre du Haut Conseil pour le climat et ancienne PDG de l’Inra lors d’une table ronde le 2 mars 2021.
Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, un petit retour en arrière est nécessaire. Après la seconde guerre mondiale, les politiques agricoles ont imposé le remembrement des très nombreuses parcelles agricoles (145 millions de parcelles en 1946, pour une moyenne de 3300 m2). Engagé dès les années 1950, le remembrement connaîtra une forte expansion de 1960 à 1980. Le but poursuivi était la modernisation de l’agriculture mais surtout, l’augmentation de ses rendements. Mécanisation, regroupements de terres, création de coopératives, la machine allait transformer considérablement nos paysages de plaines d’abord, puis de bocage. Près de 750 000 km de haies arrachées, de nombreux talus arasés, de cours d’eau asséchés, tout un écosystème vivant qui disparut derrière l’idée du progrès.
Lydia et Claude Bourguignon, connus pour leur travail sur la microbiologie des sols, plaident pour un retour à la raison dans leur Manifeste pour une agriculture durable. Leur introduction est on ne peut plus explicite: « La “révolution verte” (politique de transformation de l’agriculture fondée principalement sur l’intensification par l’utilisation de variétés de céréales à hauts rendements, d’engrais, de pesticides et d’irrigation) et la mondialisation n’ont pas tenu leurs promesses. Toutes deux sont des idéologies qui ne tiennent pas compte de la réalité et de sa complexité. Le modèle de la révolution verte est basé sur une
approche simpliste du sol, ramené au rôle de support, et sur une conception industrielle du vivant, réduit à une masse de biomolécules et de matières premières. Il a rendu l’agriculture polluante, destructrice de l’environnement, productrice de malbouffe et, de plus, incapable d’assurer la sécurité alimentaire de la France et la survie économique de ses agriculteurs. Le modèle de la mondialisation a créé une inégalité insupportable entre les mégapoles qui s’enrichissent et les campagnes qui se désertifient et s’appauvrissent, il ne permet pas de “faire « société »”.
Il fallait nourrir les populations éprouvée par les privations de la guerre, tel était l’argument principal des promoteurs et des financeurs de cette grande transformation de l’agriculture paysanne française, de cette « révolution verte ». Environ 15 millions d’hectares ont été remembrés à ce jour, sur les 26,8 millions de terres arables que compte la France. Paul Matagrin, directeur de l’École nationale supérieure d’agronomie de Rennes, prévoyait déjà dans les années 1950, « des conséquences climatiques, des problèmes d’eau, d’érosion des sols. Notre équilibre écologique ancestral s’est brisé et nous ne savons pas encore quelle sera la limite de ces destructions irréversibles. » Soixante ans plus tard, nous voyons les effets de cette marche industrielle vers la production à grande échelle de denrées échangées sur les marchés mondiaux, transportés par bateaux cargo à travers les océans. Ce sont les paysages qui nous parlent, lorsque durant les étés secs, de grands nuages de poussière viennent colorer le sillage d’un tracteur, ou lorsque les pluies tant attendues ruissellent dans les fossés, chargées d’alluvions, brunissant l’eau de nos rivières, c’est notre terre, notre trésor qui s’érode, par les airs et par les eaux. Une érosion silencieuse, qui impose son silence car elle emporte avec elle les insectes, les oiseaux et toute la faune sauvage…
Cette transformation profonde de l’écosystème dans lequel nous vivons a entrainé une modification profonde de nos êtres, de nos manières de penser ou de ne plus penser. L’abondance mondialisée a façonné nos esprits, elle a occulté nos sens premiers, nos connaissances rustiques ancestrales, elle nous a déconnecté du vivant, de la terre, du bon sens. Flattant nos envies, réduisant les distances,
effaçant les saisons, cette abondance synthétique, pauvre en goût, en minéraux et vitamines est devenue aujourd’hui une aberration contre laquelle il est essentiel de lutter. Chaque kilomètre parcouru par une denrée coûtera de plus en plus cher, chaque goutte d’eau nécessaire à sa croissance sera comptée, chaque kilowatt/heure nécessaire à sa conservation alourdira la note en monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi et surtout pour la nature, le vivant. Il paraît évident que nous devons revenir à plus de sobriété, retrouver l’abondance près de nous, accepter le rythme des saisons et cesser de collaborer à un système destructeur des humains, de la santé, de la biodiversité et de la fertilité de nos
sols.
Pour répondre à cette dérive mortifère, le concept de souveraineté alimentaire a été développé par Via Campesina et porté au débat public à l’occasion du Sommet Mondial de l’Alimentation en 1996, il présente une alternative aux politiques néo-libérales. Depuis, ce concept est devenu un thème majeur du débat agricole international, y compris dans les instances des Nations Unies. Ce fut le thème conducteur du forum des ONG parallèle au sommet mondial de l’alimentation de la FAO de juin 2002.
« La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. (…) La souveraineté alimentaire promeut un commerce transparent qui garantisse un revenu juste à tous les peuples et les droits des consommateurs à contrôler leurs aliments et leur alimentation. Elle garantit que les droits d’utiliser et de gérer nos terres, territoires, eaux, semences, bétail et biodiversité soient aux mains de ceux et celles qui produisent les aliments. »
Aujourd’hui, il est impératif pour la survie de nos terroirs, pour la sauvegarde de nos paysages, de la biodiversité et des habitants de nos contrées, d’oeuvrer pour une souveraineté alimentaire territoriale. Celle-ci peut se définir selon plusieurs critères, les esprits techniques sauront tracer des courbes et élaborer des projections, mais il est possible de l’envisager simplement. Si un fruit ou un légume est disponible à moins d’une centaine de kilomètres de son lieu de consommation, alors nous devons nous interdire d’aller le chercher plus loin. Ce simple geste, nous pouvons le faire chaque jour un peu plus. Nous pouvons agir sur le cours des choses, nous le devons pour notre avenir, nous le pouvons, mais le voulons-nous ?
Le vouloir nécessite une réelle reprise en mains de notre destin commun, il faut agir vite et de manière coordonnée, chaque individu peut s’engager pour ce changement radical que tôt ou tard nous aurons à mettre en oeuvre. Ce changement nécessite une vision partagée, un projet de bon sens et des actions coordonnées, et il ne pourra avoir lieu que dans une perspective qui respecte les droits humains, le vivant et la solidarité entre les peuples.
Tribune publiée dans le N°15 du Petit Re-Porteur.